Doué sur le plan verbal, douloureusement conscient de lui-même, délirant et problématique – il n’y a vraiment rien de comparable aux deux dernières décennies d’Eminem, l’épéiste blond.
Il a été qualifié d’un des plus grands rappeurs de tous les temps par Jay-Z et de musique pour les gens qui « boivent beaucoup trop de Mountain Dew » par Earl Sweatshirt. C’est un puriste du rap et une star de la pop, gérant des hits n°1 du Billboard Hot 100 qui n’hésitent pas à mentionner des choses comme Kool Keith et le fromage fromunda.
Il a fait l’objet d’une enquête des services secrets de George W. Bush, a été disséqué sur Twitter par Donald Trump Jr. et utilisé comme musique de pompage DNC par Barack Obama (qui gardait aussi Em sur son iPod). Il a été loué par Kanye West, Drake et Kendrick Lamar, et s’est attiré l’ire de Michael Jackson et Lynne Cheney. Il a été protesté par GLAAD et embrassé par Elton John.
Le mot « Stan » figure dans le dictionnaire (même si, pour être juste, accordons un certain crédit à Nas pour avoir officialisé son utilisation comme substantif). Son premier single au Top 10 le faisait se plaindre des boys bands, et son dernier le fait se plaindre du mumble rap. Il a reçu plus d’Oscars que Tom Cruise, Joaquin Phoenix et Edward Norton réunis. Il a vendu 11 millions d’exemplaires d’un album qui contient un sketch où les Insane Clown Posse sucent une bite.
En l’honneur du long et étrange voyage de 20 ans depuis que ce bruiteur maniaque et motard a demandé pour la première fois si nous aimions la violence, voici les albums d’Eminem classés du pire au meilleur.

Encore (2004)
Encore est un désastre décousu, qui sonne comme les impulsions indomptables de quelqu’un à qui on n’a pas dit « non » depuis une demi-décennie. Et pourquoi dirait-on non à Eminem en 2004 ? À cette époque, il était une star de cinéma, le chouchou des critiques, le propriétaire d’un label qui a lancé 50 Cent, et un lauréat d’un Oscar. Il était également accro aux pilules, ce qui explique en partie cette corne d’abondance de décisions « hickory dickory Dirk Diggler ». Parmi les choix les plus déconseillés d’Encore, on peut citer le fait de parler comme Rain Man, de faire un refrain « poo poo caca » avec un accent anglais, des bruits de vomi, des bruits de pet, des bruits de merde, des rires à la Pee-Wee Herman et, plus célèbre encore, une chanson entière rappée comme Triumph The Insult Comic Dog. Ici, l’un des plus grands rappeurs de toute une génération donne l’impression d’essayer de faire rimer des mots par la seule force de sa volonté (« merry-go », « ferris wheel », « carousel ») ou de remplir l’espace avec des absurdités funky (« Or suck a dick, and lick a dick, and eat a dick, and stick a dick in your mouth »). La chanson de Martika « Toy Soldiers », une chanson soft-pop de 1988, est transformée en une chanson sur l’éthique du bœuf ; la chanson bien intentionnée « fuck Bush » « Mosh » est auto-satisfaisante et tout en coudes ; et sa guerre avec The Source semble remarquablement datée puisque l’ère Nah Right sera sur nous dans environ un an. Le plus triste dans Encore, cependant, c’est l’incapacité à donner un sens à beaucoup de choses. Sa longue discussion sur le fait qu’il a fait exprès de rater une ligne sur « Big Weenie » est-elle un freestyle ou un écrit fait pour ressembler à un freestyle ? Pourquoi se transforme-t-il en Arnold Schwarzenegger à la fin de « Ass Like That » ?

Revival (2017)
Un album tellement brouillon qu’Eminem a sorti par surprise un meilleur album en s’adressant à tous ceux qui s’en sont plaints. Ici, le rappeur le plus vendu au monde lutte contre le Fame Monster alors qu’il entre dans l’âge mûr, empruntant les auto-examens sérieux vendus dans la friperie de Macklemore. « Believe » contient le refrain « Do you still believe … in me ? » au lieu de dire « This looks like a job for me ». Sur Revival, Em a montré les fissures de sa confiance – ce qui est remarquable puisqu’il est quelqu’un de si intimement lié à la culture du battle rap qui se gonfle la poitrine et crache du venin qu’il a joué dans son film définitif. L’homme qui a écrit « Not Afraid » voulait dire que c’est OK d’avoir peur.
Il y a des prouesses étonnantes d’agilité verbale, des schémas de rimes absurdement complexes, des scintillements de vérité et des feux d’hyperbole. Cependant, la communauté TRL qu’il se délectait à attaquer sont maintenant ses alliés, si bien que Revival s’enlise dans des ballades détrempées aux côtés d’Alicia Keys, Pink, Skylar Gray, Kehlani, X-Ambassadors et d’un sample des Cranberries. Ce n’est pas qu’Em n’est pas un balladeur évocateur, c’est qu’il sape souvent le drame avec des blagues qui passent de plus en plus pour « laborieuses » au lieu d’être « intelligentes ». « River », « Tragic Endings » et « Need Me » sont toutes des histoires sur des relations volatiles qui sont dégonflées par des jeux de mots dérisoires comme « peut-être qu’elle sera ma Gwen Stacy, pour contrarier son homme » ou « je nage dans cette rivière égyptienne, parce que je suis en déni ». Les lignes de la chanson anti-Trump « Like Home » auraient pu être tirées d’une bande dessinée de Bazooka Joe sur un emballage de chewing-gum (« ce type de problème dans lequel nous sommes est difficile à résoudre »). Ces blagues font ressembler les punchlines de 2 Chainz à celles de Mark Twain.
Et, à ce stade, Eminem a de plus en plus recours à ce qu’on ne peut décrire que comme des « Reverse Shaggy Dog Stories », déversant un tas de mots qui ressemblent à du charabia jusqu’à ce qu’ils finissent, enfin, par se fondre dans une blague. Un exemple, tiré de « Tragic Endings » : « Quand je l’ai trouvée, c’était l’amour à la première rencontre/ En plus, elle a dû prendre la boîte d’œufs sur le comptoir/ Les casser et mettre toutes les coquilles sur le sol/Pour que je marche dessus quand je suis près d’elle. » Moins on en dit sur la ligne qui commence par « Asked if she wanted a computer lodged in her vagina », mieux c’est.
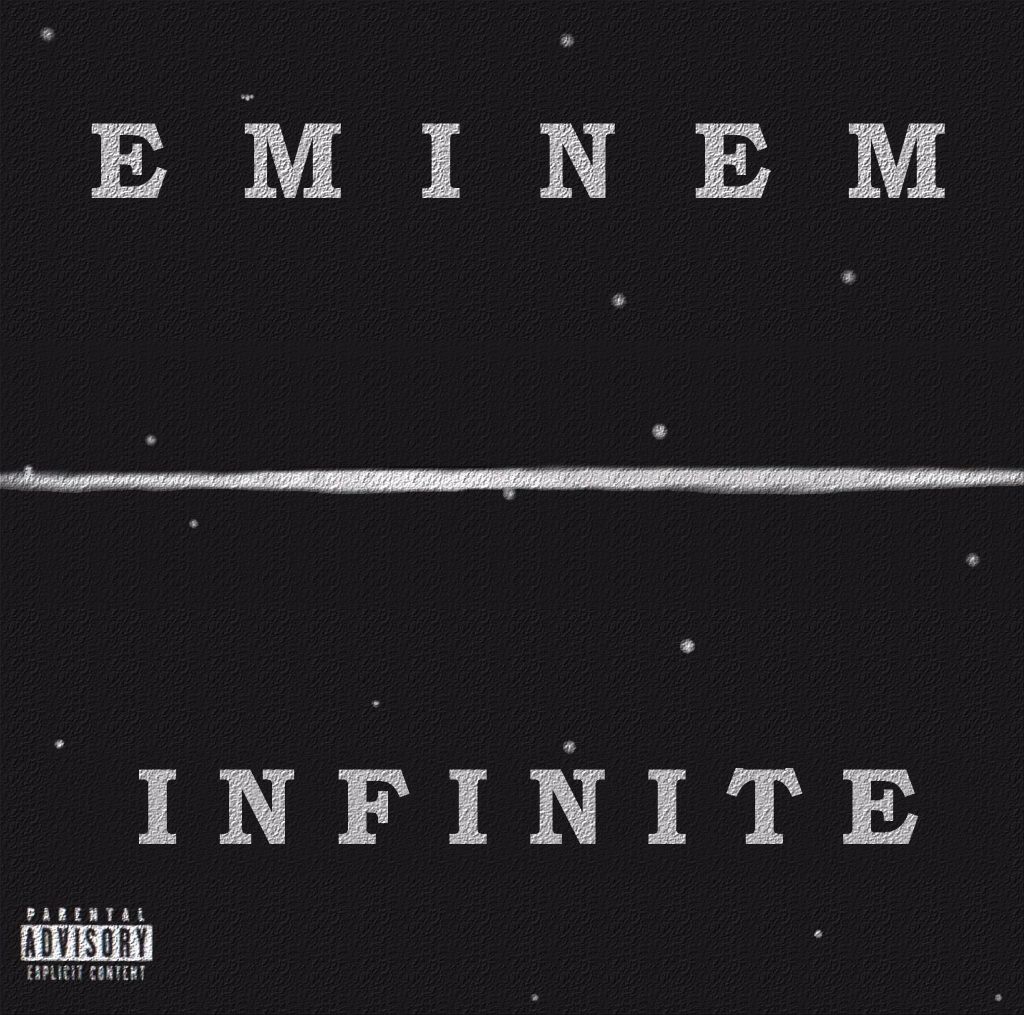
Infinite (1996)
Il y a peut-être 750 copies de cette sortie cassette/vinyle que Marshall Mathers, employé d’un restaurant, a vendue dans le coffre de sa voiture – même si Em dit : « Il s’est vendu peut-être 70 copies et n’a pas eu de grands retours. » Les labyrinthes de rimes ridicules d’Eminem étaient déjà en pleine démonstration (salve d’ouverture : « Ayo, my pen and paper cause a chain reaction/ To get your brain relaxin’, the zany-actin’ maniac in action ») et il y a les premiers indices de son blues du travailleur (la session de lutte « It’s Okay » joue comme une ébauche de « Lose Yourself »). Infinite est surtout une curiosité du classicisme boom-bap, existant dans ces douleurs de croissance de 1996 entre les rimes aspirantes commerciales de DITC et Boot Camp Clik et l’économie de l’ombre émergente des labels de rap indé comme Fondle ‘Em et Rawkus. Pour les fans de punchline rap du milieu des années 90 comme Chino XL et Akinyele, il y a de quoi sourire (« Jump the candlestick, burn your back, and fuck Jill on a hill, but you still ain’t jack ») et de nombreuses photos d’annuaire maladroites de l’époque des Olympiades du rap (« You couldn’t flip shit playin’ in toilet with a spatula »). Il y a quelques moments plus doux (« Tonite », « Searchin' ») qui ressemblent à des tentatives d’attraper la vague Bad Boy, mais surtout Infinite est juste un document lo-fi d’un remarquable MC underground avant qu’il ait sa sensibilité pop repassée.

Recovery (2010)
De toutes ses entrées de journal sanglantes, Recovery est peut-être la plus ouverte et la plus exploratoire – peut-être le véritable « Marshall Mathers LP ». C’est un disque important et peut-être nécessaire dans le canon d’Eminem, réussissant à l’empêcher de verser dans l’auto-parodie et la stagnation créative. Recovery a fait tomber le voile, laissant derrière lui bon nombre des tropes excentriques de Shadyesque – pas de sketchs avec le débauché Ken Kaniff ou le manager assiégé Paul Rosenberg, pas de meurtre de son ex-femme. À la place, on trouve des chansons d’une honnêteté criante sur le dégoût de soi, la dépendance, le chagrin, la célébrité et les relations abusives. Il a été récompensé par deux singles numéro 1 et l’album le plus vendu de sa carrière post-réhabilitation. Alors pourquoi classé si bas ?
Tout d’abord, malgré les couplets auto-excoratifs d’Eminem, la production est du pur rap de gladiateur : grandiloquente, prête à la fanfare, voire un peu manipulatrice. Parmi les échantillons, citons le tube eurohouse fromagé de Haddaway « What Is Love », la ballade sur-utilisée de Black Sabbath « Changes » et le tube gothique pop syntaxique de Gerald McMann « Cry Little Sister » du film Lost Boys, un gâteau au fromage pour vampires des années 80. Alors qu’Eminem dénonçait autrefois les radios pop, il les imite aujourd’hui avec le refrain pleurnichard de « Talkin’ 2 Myself » et les roucoulements britanniques de « Almost Famous ». Et, en tant que rappeur, Eminem a vraiment commencé à transformer ses punchlines en blagues de papa classées R, des gémissements qui franchissent la ligne entre l’intelligence et l’ennui. En témoignent des répliques comme « Stick my dick in a circle, but I’m not fucking a-round » (« Cold Wind Blows ») ou « Your pussy lyric, I cunt hear it » ou encore la réplique infâme du hit « Love The Way You Lie », « Now you get to watch her leave out the window/ Guess that’s why they call it window pane ». L’un des albums les plus ouverts et les plus matures de sa carrière, mais il est mis sur la touche par des choix de production grandiloquents et un bol plat de jeux de mots.

Kamikaze (2018)
La raclée critique quasi-universelle de cet éparpilleur de rimes chauffé à blanc était soit un lay-up post-Revival pour frapper une cible facile, soit simplement un signe que le hip-hop moderne valorise simplement des choses bien au-delà de la portée des principes originaux du rap. Une grande partie de Kamikaze est un exposé pyrotechnique des griefs du Jeffrey Ross du rap, qui fait des rimes de combat à rebours dans la tradition des joutes en direct des années 80, des Scribble Jams des années 90 et des Smack DVD des années 2000. Ses paroles atteignent un niveau d’absurdité à la Seussie, faisant rimer « vieux lederhosen » avec « explosions artisanales » et « poster de Young Thug » avec « grille-pain débranché ». Les trois chansons de l’ex-copine folle, les excuses aux membres de l’équipe D-12 et le lien avec Venom alourdissent le projet dans son ensemble – bien que ce dernier permette au moins à un fan de BD de longue date de trouver des rimes pour « mitochondrial » et « Symbiote ». Passez directement aux six autres chansons – « The Ringer », « Greatest », « Lucky You », « Not Alike », « Kamikaze » et « Fall » – pour un cyclone de pluie acide, Eminem s’attaquant à une longue liste de cibles : notamment Machine Gun Kelly, mais aussi Vince Staples, Charlemagne, Tyler, Earl Sweatshirt, Joe Budden, Akademiks, Pitchfork, les Grammys, le flow des Migos, le mumble rap, AutoTune, Trump, Lord Jamar et Die Antwoord. Un EP incroyable de pure berserkitude à la chaleur de mixtape pulvérisée sur une collection inégale.

Relapse (2009)
Eminem a émergé de son hiatus en cure de désintoxication en tant que nerd des mots farfelus, combinant les syllabes de manière étonnante et souvent absurde. Était-ce de la clarté ? De l’ennui ? UN TROUBLE OBSESSIONNEL COMPULSIF ? Peu importe, car son premier album en presque cinq ans l’a réinventé comme le Ogden Nash du flog ‘n’ slash. L’inconvénient, bien sûr, c’est que le sens et l’impact réels des mots ont commencé à s’estomper. Certes, c’est un exploit louable et gynécologique de rapper « Hannah Montana, prépare-toi à t’enfuir avec un ouvre-boîte/et à être découpée comme un cantaloup sur un lit à baldaquin », mais ce n’est pas aussi évocateur que, disons, la lettre de Stan ou le pull de B-Rabbit. Le récit d’overdose « Déjà Vu » et la séance de thérapie contre le syndrome de la page blanche « Beautiful » viennent vers la fin de l’album, essentiellement des îlots de vérité sur un album d’éclaboussures horrorcore, d’hyperboles folles et d’étalages ridicules de rimes. En ce qui concerne les raps, il s’agit essentiellement d’un disque de genre excessif, un artisan traitant plus de fiction que de réalité, pour les fans des Geto Boys, de Tech N9ne ou du Slim Shady LP. C’est un film de Troma qui fait pour le rap choc ce que Jay-Z a fait pour le rap criminel avec American Gangster en 2007. Malheureusement, Em porte aussi une garde-robe d’accents comme s’il faisait toujours un numéro de Sacha Baron Cohen. Mais pour le type de fan de rap bars-avant-tout ouvert à entendre quelqu’un dire, « Time to show you the most kick-ass flow in the cosmos/ Picasso with a pick axe, a sick asshole », il y a beaucoup à aimer.

The Eminem Show (2002)
Le troisième volet de la série classique d’Eminem sur les majors est celui où il sort de ses ébats à l’intérieur du hall des miroirs médiatiques et commence à dire simplement des morsures de réalité, à parler ouvertement d’affaires judiciaires oubliées depuis longtemps et de bastons abandonnées depuis longtemps. C’est un peu sérieux et moralisateur, avec des chansons comme « Sing For The Moment » et « My Dad’s Gone Crazy » sur le pouvoir de guérison de sa propre musique. Eminem a vraiment pris les rênes en tant que producteur pour la première fois – il est crédité en tant que seul ou coproducteur sur toutes les chansons de Dr. Dre, à l’exception de trois d’entre elles – et il penche vraiment vers des rythmes martiaux, plombés et surdramatisés. Il n’en reste pas moins un rimeur hors pair, capable de balancer librement des vers délirants comme « I’m interesting, the best thing since wrestling/ Infesting in your kids’ ears and nesting » ou « full of controversy until I retire my jersey/ Till the fire inside dies and expires at 30 ». Il s’agit en fait d’un album de préparation à « Lose Yourself », où Em n’est plus un crétin psychopathe mais un soldat concentré et un Superman, où il préfère rapper sur une ballade d’Aerosmith plutôt que sur un riff d’orgue de Labi Siffre. Il y a « Cleaning Out My Closet », la chanson brute point par point de dissidence à sa propre mère (il dit qu’il ne la jouera plus), et le délirant « Without Me », dont l’interpolation d’un autre interlope blanc très critiqué, Malcolm McClaren, sur « Buffalo Gals », était soit un pur génie, soit une coïncidence hilarante.

The Marshall Mathers LP 2 (2013)
S’il existe un album de rap plus purement technique, je ne l’ai pas entendu. Cette collection athlétique de raps cascadeurs est le hip-hop qu’ont connu Grandmaster Caz, Big Daddy Kane et Kool G Rap : la science des syllabes, un concours de pisse de combinaisons délicates et de sauts de haies assonantes mettant à mal tous les débutants. En 2013, les styles de rap ont évolué pour inclure le reportage de rue de Kendrick Lamar, le minimalisme bricolé de Chief Keef, le gargarisme mélodique de Future, la chanson de Drake et le chaos de Young Thug. Mais si vous êtes en âge d’apprécier une bonne blague de Kwamé (« Love Game »), cet album est tout simplement remarquable. Ici, une pop star se transforme en Buckethead ou DJ QBert du rap, poussant son instrument jusqu’à des limites fantastiques, débordant sur les bords. Rick Rubin est aux platines pour la première fois, et emprunte la voie des samples rock en boucle de Joe Walsh, Zombies, Billy Squier et Wayne Fontana. « So Far… » est probablement son meilleur morceau solo post-réhabilitation, un morceau « vieux rappeur qui hurle sur les nuages » où Em documente de façon hilarante sa frustration face aux ordinateurs, aux fans qui lui font remarquer ses pattes d’oie et à la prochaine génération de Slim Shadys. « Headlights » est probablement sa chanson la plus sobre et la plus honnête, une excuse déchirante à sa mère pour avoir passé des années à nettoyer son placard à paroles. Si vous pouvez supporter le moment occasionnel de « rapper comme Yoda » ou le refrain treacley de Skylar Grey, MMLP2 est un exemple phénoménal de « rap rappé » qui, dans le cas d’une chanson, a littéralement battu un record Guinness.

The Slim Shady LP (1999)
Le doigt gluant qui a mouillé l’Amérique de Willie. Bratty et beastie, les débuts d’Eminem sur un label majeur ont été une sensation instantanée grâce à ses fricassées de culture pop sarcastique, ses shock-raps aiguisés, trois singles excentriques produits par l’ambassadeur gangsta Dr. Dre, et un morceau macabre de rap hors-la-loi sur l’abandon du corps de sa babymama dans un lac. Avec une vente à l’image de Barnum et une exploitation tordue de la shoxploitation des débuts de Wes Craven, les lignes d’Eminem sur le fait d’être un paratonnerre pour la controverse sont rapidement devenues une prophétie auto-réalisatrice. Cependant, le véritable triomphe de The Slim Shady LP ne réside pas dans ses blagues sur les Spice Girls et ses dégoûts misogynes, mais dans le fait qu’il renverse artistiquement le scénario de la bravade rap, transformant les postures « you ain’t shit » de L.L. Cool J et Kool Moe Dee en postures « I ain’t shit » de Woody Allen et Rodney Dangerfield. Laissez à Rakim le soin de ne pas être une blague : Le personnage de Slim Shady est un masturbateur compulsif, un toxicomane, un connard ingrat envers ses fans, un maigre, un fauché, un colérique, un jaloux de mauvaise influence qui crache quand il parle, déteste son travail et se vante d’avoir des verrues génitales, de l’herpès, la syphilis, « le SIDA à part entière et un mal de gorge ». Dans ses moments les plus venimeux, il s’en prend à son père mauvais payeur, à la brute du collège, à son ex-petite amie, à sa mère – ce qui lui vaudra même deux procès. En tant que garçon blanc, Eminem est venu de l’extérieur des murs de la culture hip-hop, mais il a finalement utilisé ses méthodes de narration pour raconter sa propre réalité.

The Marshall Mathers LP (2000)
Eminem était le plus convaincant lorsque ses paroles clouaient au centre d’un diagramme de Venn fiction brillante et faits laids, rancunes personnelles et batailles publiques, l’imagination d’un pervers de grindhouse et l’attrait d’une pop star. Avec The Marshall Mathers LP, les critiques se sont battus pour savoir s’il était un baril toxique d’homophobie et de misogynie qui fuyait ou le Bob Dylan surdoué du trailer park. The Marshall Mathers LP comprenait le vif « Stan », peut-être le seul rap narratif à rivaliser avec la grandeur de « Children’s Story » de Slick Rick, et il comporte également des aiguilles autoconsciemment antagonistes de « Fuck, shit, ass, bitch, cunt, shooby-de-doo-wop/ Skibbedy-be-bop-a-Christopher-Reeves. »
Ici, Eminem était un rêve de tabloïd prétendant être le cauchemar de l’Amérique moyenne. Sa vie personnelle était exposée d’une manière à la fois inconfortable et intrigante à l’époque pré-TMZ, s’en prenant à sa mère, aux médias et aux gens qui le dérangent quand il mange. Et puis, bien sûr, il y a « Kim », une séance de thérapie par le cri wagnérien où il tue son ex sur disque… pour la deuxième fois. Dans son pire aspect, « Kim » est une attaque misogyne dirigée contre une personne réelle qui n’a pas de contrat d’enregistrement pour se défendre ; dans son meilleur aspect, c’est « Stagger Lee » à la Lars Von Trier, complet avec l’anti-héros qui s’effiloche dans la distraction, le dégoût de soi et les souvenirs vacillants.
Cette ligne de « Marshall Mathers » est à la fois l’une des plus brillantes techniquement de l’album et l’une de ses plus indéfendables : « J’ai été mis ici pour mettre la peur/ Dans les pédés qui pulvérisent de la bière de racine Faygo/ Et qui se font appeler clowns parce qu’ils ont l’air pédés ». Les rimes internes et le rythme sont délicieux comme ceux de Big Daddy Kane. La mesquinerie de se battre avec ICP pour la suite d’un album triple platine d’Interscope est hilarante. L’homophobie désinvolte est éthiquement inexcusable, mais elle est brute comme une crise de colère. C’est ce jeu d’équilibre entre les impulsions – le génie et la stupidité, le savoir-faire et l’infantilisme, les compétences brutes et les tactiques de choc, les démons personnels et les débordements publics – qui a rendu Eminem et The Marshall Mathers LP si intrigants.